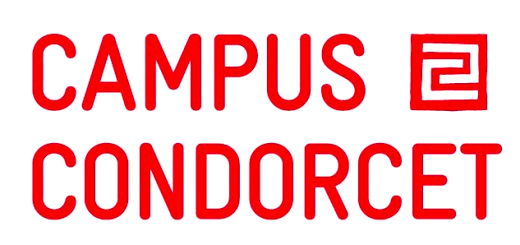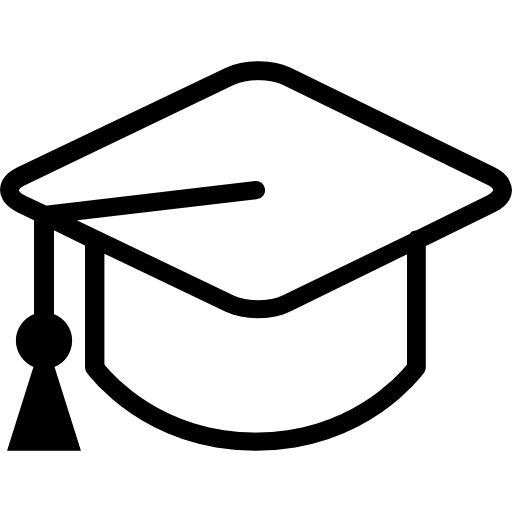
Titre de la thèse
Faire corps avec ses sols – Être maraicher biologique ou l’art de percevoir et de composer avec une multitude d’entités.
La thèse a été réalisée sous la direction de Frédérique Chlous et de Joanne Clavel, au sein de l’UMR PALOC.
Le jury est composé de :
– Jérémie Forney, Professeur ordinaire, Université de Neuchâtel – Rapporteur
– Céline Granjou, Directrice de recherche, LISIS – Rapportrice
– Anne Sourdril, Chargée de recherche, LADYSS – Examinatrice
– Laurent Hazard, Directeur de recherche, AGIR – Examinateur
– Frédérique Chlous, Professeure, PALOC – Directrice de thèse
– Joanne Clavel, Chargée de recherche, LADYSS – Co-directrice de thèse
Résumé de la thèse
En Seine-et-Marne, alors que la céréaliculture conventionnelle est majoritaire, des maraîchers développent dans les interstices de ce paysage agricole de petites fermes en agriculture biologique. Ces maraîchers sont notamment des néopaysans non issus du milieu agricole avec un engagement écologique fort et qui défendent la commercialisation de leurs légumes en circuits courts, via des Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. C’est à la relation que ces maraîchers développent avec leurs sols que cette thèse s’intéresse, à travers l’exemple de deux maraîchers qui travaillent le sol, et d’un maraîcher et une maraîchère qui ont décidé de ne pas travailler leurs sols. En suivant ces trois maraîchers et cette maraîchère, ainsi que la trajectoire d’agriculteurs biologiques seine-et-marnais les environnant, ce travail aborde la manière dont ils définissent, perçoivent et composent au quotidien avec la multitude d’entités qui composent leurs sols (eau, air, champignons, détritivores, nutriments, bactéries, argiles, roches, etc.). Pour cela, je m’appuie sur des enquêtes ethnographiques reposant sur une immersion et de la participation observante, ainsi que sur la création d’une méthode d’enquête originale inspirée du monde de l’art. Ces enquêtes montrent qu’il n’existe pas un sol mais des sols sur une ferme maraîchère, entre l’espace productif des planches de cultures et les différents sols qui les entourent, de celui du sol inerte des chemins à ceux dont la vitalité est valorisée. A ce premier acte de définition fonctionnelle des sols s’ajoute un second, celui de définir un sol idéal (meuble, fin, riche et vivant) vers lequel ils vont faire tendre le sol de leurs planches cultivées. Cet idéal est aussi bien agronomique qu’un idéal de relation entre le corps du maraîcher et la matérialité de ses sols, visant à réduire autant que possible la pénibilité du travail. Les perceptions qui leur permettent d’évaluer le caractère plus ou moins meuble, fin, riche et vivant de leurs sols, reposent sur des ressentis tactiles, olfactifs, visuels, auditifs et kinesthésiques, et se développent grâce à une immersion corporelle quotidienne dans leur jardin. Cela passe notamment par une adaptation et une inventivité du corps du maraîcher face aux contraintes du milieu, perfectionnées par des années de pratique ainsi que par le déploiement de plusieurs modes d’attention. Le développement de ces perceptions passe aussi par un ensemble de connaissances théoriques et pratiques acquises lors de formations, sur internet, dans les échanges entre maraîchers. Ce sont ces perceptions qui permettent aux maraîchers de composer avec les entités qui peuplent leurs sols, et ces actions de composition qui en retour participent du développement de nouvelles perceptions. Je me suis intéressée à deux agencements en particulier pour illustrer ces relations aux entités, celui qui mène à avoir un sol riche et celui qui mène à ameublir le sol. Je montre la manière dont les maraîchers deviennent une entité à part entière du flux de nutriments et de matière organique de ces sols, et les relations de don-contre don qu’ils instaurent avec ces derniers. Puis, je m’intéresse aux différentes manières dont ils composent avec l’air de leurs sols, avec d’un côté ceux qui s’appuient sur un usage toujours contextualisé de machines agricoles pour travailler leurs sols, et de l’autre ceux qui s’appuient sur l’action des organismes vivants du sol pour travailler le sol à leur place, avec une réflexion sur la notion de travail mobilisée dans ce contexte.
Abstract
In Seine-et-Marne, where conventional cereal growing is predominant, market gardeners are developing small organic farms in the interstices of this agricultural landscape. In particular, these market gardeners are new farmers with no farming background and a strong ecological commitment, who are promoting the marketing of their vegetables through short distribution channels, via Associations for the Maintenance of Small-scale Farming. This thesis looks at the relationship that these market gardeners develop with their soil, through the example of two market gardeners who work the soil, and two market gardener who have decided not to work their soil. By following these four market gardeners, as well as the trajectory of the organic farmers in the Seine-et-Marne surrounding them, this work addresses the way in which they define, perceive and deal on a daily basis with the multitude of entities that make up their soil (water, air, fungi, nutrients, bacteria, clays, rocks, etc.). To do this, I rely on ethnographic surveys based on immersion and observing participation, as well as on the creation of an original survey method inspired by the world of art.
These surveys show that there is not one soil but many soils on a market-garden farm, between the productive space of the crop beds and the different soils that surround them, from the inert soil of the paths to those whose vitality is valued. In addition to this first act of functionally defining the soil, there is a second act, that of defining an ideal soil (loose, fine, rich and alive) towards which they will make the soil of the cultivated beds strive. This ideal is both agronomic and in terms of the relationship between the market gardener’s body and that of the soil, with the aim of making the work as painless as possible. The perceptions that enable them to assess how loose, fine, rich and alive their soil is are based on tactile, olfactory, visual, auditory and kinaesthetic sensations, and are developed through daily physical immersion in their garden. In particular, this involves the market gardener’s body adapting and becoming inventive in the face of the constraints of the environment, perfected by years of practice, as well as deploying several modes of attention. The development of these perceptions also depends on a body of theoretical and practical knowledge acquired through training courses, the internet and exchanges between market gardeners. It is these perceptions that enable market gardeners to compose with the entities that populate their soils, and these compositional actions that in turn contribute to the development of new perceptions. I have focused on two arrangements in particular to illustrate these relationships with entities, the one that leads to having rich soil and the one that leads to loosening the soil. I show how market gardeners become an entity in their own right in the flow of nutrients and organic matter in these soils, and the give-and-take relationship they establish with it. I then look at the different ways in which they deal with the air in their soils, with, on the one hand, those who rely on the contextualised use of agricultural machinery to work their soils and, on the other, those who rely on the action of living soil organisms to work the soil for them, and reflect on the notion of work used in this context.
1757066400
Vendredi 5 septembre 2025 à 10h, Université Paris Cité, Hall aux Farines, Salle 580F (monter l'escalier F)
1752069600
Mercredi 09 juillet 2025 à 14h00, Centre Panthéon-Sorbonne (12 place du Panthéon, 75005, Paris ), salle 6
1750960800
Jeudi 26 juin 2025 de 18h à 19h30 (Distanciel)
1750759200
Mardi 24 juin 2025, 10h00-12h30, Université Paris 8 Saint-Denis, salle A2-217
1750356000
Jeudi 19 juin 2025 de 18h à 19h30 (Distanciel)
1750338000
Jeudi 19 juin 2025 de 13h à 14h30, à distance (voir "Lire plus")
1750064400
Lundi 16 et Mardi 17 juin 2025, Université Paris-Nanterre et Bergerie de Villarceaux (Chaussy), inscription avt le 06 juin
1749736800
Jeudi 12 juin 2025 de 14h00 à 16h30, Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Sud, salle 2.122
1749718800
Jeudi 12 juin - Vendredi 13 juin 2025, Université Paris-Cité, Bâtiment Olympe de Gouges, Salle 209