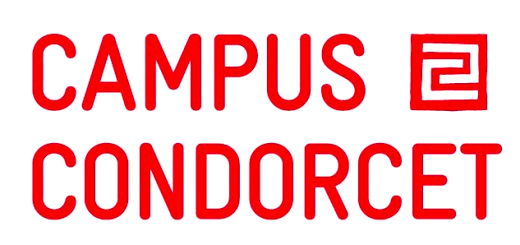Docteur
Université Paris Cité
École doctorale Sciences des sociétés (ED 624)
Thèse soutenue le 15/09/2023.
Master d’origine : Master BIOTERRE
Directrice de thèse : Nathalie BLANC
innovation socio-écologique ; action citoyenne ; biodiversité urbaine ; bénévolat ; gouvernance ; méthode géo-ethnographique ; Grand Paris ; New York City
Renaturation urbaine et actions citoyennes : vers une co-production de la ville écologique ? Etudes de cas dans le Grand Paris et à New York City.
Inscrite en géographie environnementale et urbaine, cette thèse propose d’analyser des formes émergentes d’actions collectives et citoyennes en faveur de la renaturation des milieux urbains. L’étude s’appuie sur trois cas d’initiatives locales revendiquant une action bénéfique pour la biodiversité, dans deux contextes métropolitains : celui du Grand Paris (Paris et Massy) et de New York City (Gowanus, Brooklyn). Ces actions collectives se caractérisent par leur démarche partenariale avec les pouvoirs publics municipaux et par l’implication locale des acteurs techniques, politiques ainsi que d’habitants. Plusieurs registres d’action sont observés, allant de l’action directe (plantation, aménagement d’habitats pour la faune), au plaidoyer auprès des autorités publiques, en passant par l’éducation et la transmission de nouveaux savoir-faire aux habitants. Grâce à une méthode d’enquête qualitative, nous interrogeons aussi, de façon critique, les reconfigurations et les tensions à l’oeuvre en matière de gouvernance et de production des espaces urbains de nature. En croisant des données écologiques (relevés floristiques, analyse de réseau écologique) et ethnographiques (participation observante et entretiens semi-directifs), il s’agit d’étudier les impacts multi-scalaires de ces actions collectives inscrites dans différentes dynamiques territoriales. Le choix d’une mise en perspective internationale permet d’interroger la capacité des acteurs citoyens à transformer, par leurs actions, les structures sociales, politiques et organisationnelles de chaque territoire urbain. Finalement, nos résultats contribuent à enrichir le concept d’innovation socio-écologique. Ils montrent que les initiatives citoyennes étudiées peuvent participer à la co-production d’espaces publics de nature en ville, en générant de nouveaux bénéfices écologiques et en expérimentant de nouvelles alliances territoriales (entre des acteurs citoyens, techniques et politiques) et interspécifiques (entre une biodiversité et des habitants citadins).